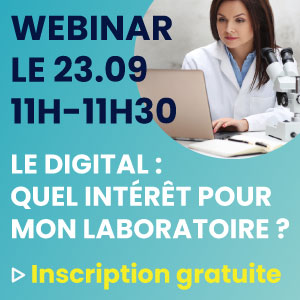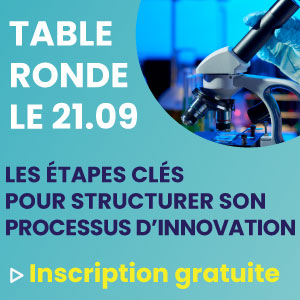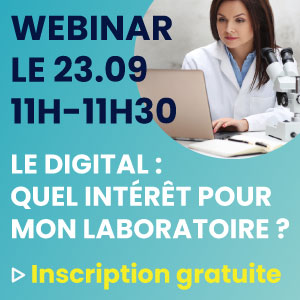Imaginée depuis près de 5 ans, KYLI propose aux laboratoires de recherche scientifique une solution de digitalisation des activités R&D améliorant la collaboration, le contrôle qualité et la sécurité des données. Basée à Montpellier, KYLI commercialise la solution logicielle LABY et prépare d’ores et déjà l’avenir en investissant en R&D pour être capable d’accompagner et répondre aux besoins futurs des experts scientifiques notamment dans le domaine de la data science et le machine Learning.
Benjamin Jacquot, co-fondateur et Président de KYLI nous présente cette jeune entreprise bien dans son temps qui bouillonne d’idées pour faciliter et fiabiliser le travail des scientifiques.
Quel est en quelques mots votre parcours professionnel ?
J’ai toujours été attiré par la science avec l’idée de pouvoir apporter quelque chose à la société.
Après un Master en Biotechnologies j’ai intégré l’univers de la recherche chez Cisbio ou j’ai eu l’opportunité de développer un kit de diagnostic in vitro de la phase de recherche à sa commercialisation.
Pour moi la recherche ne s’arrête pas à la paillasse, j’ai donc poursuivi mes études par un MBA à l’IAE.
Benjamin jacquot, co-fondateur et président de KYLI
Puis j’ai intégré MedinCell pendant presque 10 ans. Là j’ai travaillé sur des projets de recherche et en parallèle j’ai été responsable de projets gestion et finance, en mode start-up.
Avec le développement de l’entreprise, j’ai pris en charge la gestion de la plateforme des budgets avec un grand partenaire big pharma.
Comment a émergé le projet qu’est devenu KYLI ?
En 2014, MedinCell avait le projet de se digitaliser en créant sa propre application car les solutions existantes sur le marché n’étaient pas complètement satisfaisantes (trop chères, trop spécialisées et peu adaptées à son usage…)
J’ai pris en charge ce projet et initié les premiers développements. Très vite, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup à faire et à gagner dans l’accompagnement des travaux de recherche.
Nous avons constitué une équipe experte en informatique et fait évoluer la solution en suivant la croissance de la structure et les besoins des scientifiques au sein du laboratoire, un véritable test grandeur nature !
Après 4 ans, nous avons convenu de créer une structure indépendante et nous avons co-fondé en 2019 KYLI avec 4 collaborateurs déjà impliqués dans le projet. Dans le même esprit que le modèle que nous avions connu chez notre dernier employeur, nous permettons à tous nos collaborateurs de devenir associés. Ceci est très important pour nous et montre qu’il y a des modèles économiques viables permettant à tous de profiter de la valeur que chacun participe à créer.
Notre motivation est d’être un acteur majeur dans l’écosystème scientifique et d’amener notre pierre à l’édifice.
Quel est le savoir-faire spécifique de votre entreprise ?
 LABY est un « ELN/LIMS » (ndlr : Electronic Laboratory Notebook – Lab Information Management System) tout en un. Il permet à la fois d’enregistrer les données de laboratoire mais aussi de gérer les stocks, les équipements, la documentation qualité, la bibliographie… et tout ce qui est nécessaire à la traçabilité des données.
LABY est un « ELN/LIMS » (ndlr : Electronic Laboratory Notebook – Lab Information Management System) tout en un. Il permet à la fois d’enregistrer les données de laboratoire mais aussi de gérer les stocks, les équipements, la documentation qualité, la bibliographie… et tout ce qui est nécessaire à la traçabilité des données.
Nous avons baigné dans l’opérationnel pour monter l’outil. L’idée a été testée sur le marché et a évolué en fonction des besoins. Ainsi actuellement notre produit LABY peut couvrir tous les besoins de la start-up jusqu’à une entreprise cotée en bourse comme MedinCell.
Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents ?
Le démarrage, la formation et l’utilisation de LABY sont simples, tout est facile à mettre en place. Nous avons vraiment à cœur de placer nos utilisateurs au centre de nos réflexions et nous orientons nos développements en fonction de leurs besoins.
En second lieu, notre offre est unique avec un tarif clairement affiché et bas comparativement au marché. Il s’agit d’une solution complète permettant de suivre un projet R&D de A à Z avec un abonnement par utilisateur et par mois. Contrairement aux solutions concurrentes qui sont souvent morcelées, tout est intégré dans la solution LABY, il n’y a pas de mauvaise surprise lorsque la structure évolue. Ceci est une réelle volonté de notre part afin de pouvoir toucher un maximum de laboratoires ayant des budgets limités mais de grandes ambitions !
Enfin LABY accompagne les clients dans leur croissance et l’impact économique de notre solution est important : une fois en place le client est tranquille pour des années. LABY s’adresse aux structures tournées vers l’avenir !
Avez-vous d’autres ambitions dans le domaine des données scientifiques ?
Oui, actuellement LABY est un hub de data scientifiques mais nous souhaitons proposer une offre complémentaire avec des fonctions d’analyse de données par l’intelligence artificielle, un projet que nous développons en collaboration avec l’ISDM (ndlr : Institut de Science des Données de Montpellier).
Nous avons travaillé sur une POC (ndlr : Proof Of Concept) avec la société toulousaine Enterosys (ndlr : dirigé par Maxime Fontanié, ancien Président et membre de Biomed Alliance et aussi dirigeant de la société Vibiosphen).
Ce projet fait partie de la genèse même de LABY et maintenant nous avons la capacité de le réaliser.
Il nous a permis d’être lauréat du LAB Start-up 2021 et de présenter le projet lors du Forum Labo qui se tiendra à Paris du 5 au 7 octobre 2021, sur lequel nous aurons plaisir à vous rencontrer !
Ce projet innovant, soutenu également par Bpifrance dans le cadre de notre label Deeptech, est dédié aux laboratoires académiques et privés en Recherche, Analyse et Contrôle dans les domaines de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, de l’agroalimentaire, de la cosmétologie, de l’environnement.
Que pensez-vous de l’état de la digitalisation en France ?
En France les usages commencent à évoluer et il y a encore des besoins inexploités.
La crise de la Covid a démontré qu’il y a une réelle nécessité d’avoir à disposition des informations à distance de manière sécurisée. Cette crise a ouvert la curiosité des laboratoires français et le marché évolue. Néanmoins, malgré l’accélération de la transformation digitale en France, il y a encore un manque d’information et de formation et nous avons pris du retard sur d’autres pays qui ont amorcé cette transformation plus tôt et qui continuent à innover.
Comment KYLI participe-t-elle à la transformation digitale en France ?
En formant et informant. Nous avons approché quelques universités dans l’objectif de les sensibiliser et permettre de vulgariser le digital dans la recherche. Nous avons la volonté d’informer les chercheurs sur les avantages de ce type d’outil et leur faire savoir ce que sera leur métier de demain : La question n’étant plus « est-ce que je dois me digitaliser » mais « comment me digitaliser au mieux ».
Quelles est la plus belle réussite de votre entreprise/entreprenariat ?
Être passé de l’idée aux contrats, avec des clients qui sont aussi des partenaires.
Ceci a été permis notamment grâce à l’implication de l’équipe dans la réussite de la société. L’aspect humain et la réussite du management collaboratif que nous pratiquons est aussi un important motif de satisfaction.
Les premières récompenses de KYLI validant le projet sont aussi des éléments de satisfaction et de gain de confiance. LABY a été lauréat notamment de Creacc, du forum Labo, de la BFT (ndlr : dispositif Bourse French Tech avec BPI.
Avec le recul qu’est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours de création/développement de votre entreprise ?
Avec le recul nous n’aurions peut-être pas créé KYLI 3 mois avant la Covid !!…. Ça a été un énorme exercice pour repenser tout le modèle sur lequel nous nous étions basés à la création.
Nous avons aussi eu à cœur de proposer un projet abouti à nos clients donc tous les efforts ont été mis sur la conception de l’outil et son enrichissement et la partie commerciale a été négligée dans un premier temps.
Enfin, nous n’avons pas encore validé notre statut de JEI (ndlr : Jeune Entreprise Innovante). Nous sommes sur des sujets très complexes par rapport à l’intelligence artificielle. Nous avons voulu monter ce dossier en solo en se focalisant sur la description de l’innovation mais malgré la terminologie, l’obtention du statut est soumise au caractère de recherche et non d’innovation. Nous aurions gagné du temps en nous faisant accompagner par un expert. D’un autre côté, cet exercice nous a permis d’affiner notre communication et de mettre en avant le bénéfice à l’utilisateur et non plus l’explication technique de l’outil.
Quels ont été ou sont au contraire les éléments facilitateurs ?
Nous avons participé au jumping création du BIC (Business & Innovation Center, Montpellier), ce qui nous a permis d’être très challengés en amont de l’incubation. Puis le BIC nous a accompagné dans la création et nous avons eu accès rapidement à des locaux au sein de l’incubateur CAP OMEGA. L’obtention du prêt d’honneur CREALIA a également joué un rôle majeur, nous permettant de renforcer les fonds propres pour se dimensionner en préalable des demandes de subventions auprès d’ADD’OC (start’OC) et la BPI (BFT).
Les dispositifs d’accompagnement des sociétés mis en place par l’État nous ont aussi bien épaulé au début de la période Covid.
Enfin, s’inscrire dans un réseau d’entreprises innovantes est aussi une aide. Par exemple dans le réseau BIOMED Alliance, nous avons trouvé de la proximité et des échanges fructueux, lors des ateliers métiers notamment. C’est un réseau de partage très humain et animé que nous apprécions beaucoup.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs/entreprises ?
De ne pas attendre que son produit soit parfait pour le tester auprès du client. Au plus tôt l’idée est testée sur le marché, au mieux c’est, ensuite on ajuste. Par exemple, après une demande de la part de plusieurs clients, nous avons ajouté un Gantt automatisé à notre solution.En moins de 2 semaines, la première version de cette fonctionnalité a été mise en place et est maintenant en production!
Claire Toutin
BIOMED Alliance
BMA souhaite remercier Benjamin Jacquot et Stéphanie Laluque pour leur disponibilité et la qualité des échanges lors de la préparation de cet article.
———————————————————————
Cet article est issu de propos libre récoltés lors d’un entretien, avec l’aimable autorisation de Monsieur Benjamin Jacquot, Président de KYLI.
———————————————————————
KYLI : https://www.biomedalliance.fr/entreprise/kyli/
Retrouvez KYLI à Montpellier
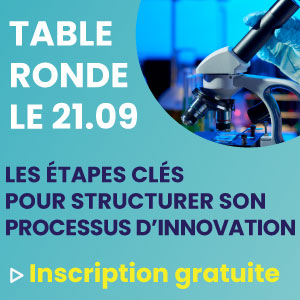
et au webinaire